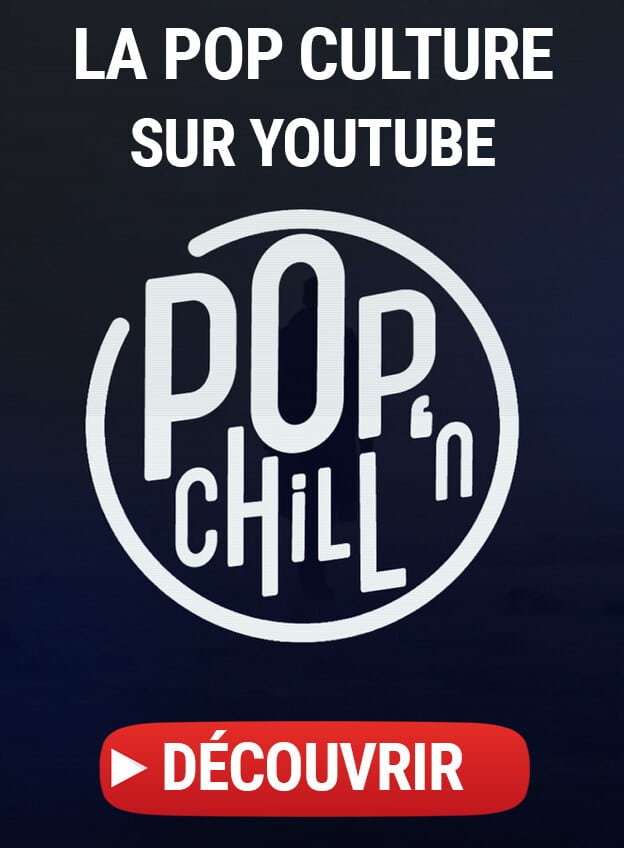L’Idéal, deuxième film de l’écrivain/réalisateur Frédéric Beigbeder, est aussi l’adaptation directe de son roman « Au secours pardon ».
Le contrat de confiance
Après la bluette romantico-nihiliste qu’était l’Amour dure trois ans, il semblerait qu’un même programme soit à l’œuvre ici. Beigbeder s’attaque en effet à un projet dont les thématiques semblent au premier abord différer radicalement, alors qu’elles se radicalisent en fait ; encore plus noires, plus cyniques, plus mauvais genre. C’est d’ailleurs la promesse que nous vend l’affiche du film, qui n’est rien d’autre qu’une caricature publicitaire pour du vernis à ongles, dans laquelle le « mannequin main » nous adresse gentiment un doigt d’honneur.
Après visionnage, il est clair que cette affiche est inattaquable, tant elle résume admirablement le contenu du film. En une phrase : l’histoire de personnages désenchantés à l’humour pas très finaud, dont l’existence est engluée dans l’imagerie publicitaire.
Pour les connaisseurs, il n’y a guère de surprise à attendre de ce côté là. Le film s’évertue à conserver ce qui a toujours fait le succès de tout « bon Beigbeder » ; ce ton bouffon-amer caractéristique, ainsi qu’une forte tendance à l’égo trip sur-dimensionné.
Comme dans 99 francs, l’on suit le personnage d’Octave, qui a troqué son activité de pubard pour une carrière de « model scout » dans les pays de l’Est. C’est aussi un changement de trogne, car les traits du double Beigbedien sont passés de Dujardin à Gaspard Proust ici, autant d’avatars que l’auteur/réalisateur peut transposer et transformer à sa guise, adapter à chaque tranche de vie qui lui sont propres, à mi-chemin entre un François Pignon version déglingue, et un Woody Allen qui n’aurait plus grand chose d’humain.
Au fond c’est pô ma faute…
Après une mise en bouche clairement autobiographique, où l’on découvre l’enfance d’Octave/Beigbeder (appelons-le Beigdave à partir de là), biberonné depuis les origines aux soirées orgiaques et alcoolisées au sein même de son foyer, l’on comprend instantanément que le film met en place un pacte de sincérité, façon Rousseau. Car cette ouverture est en fait la confession d’une fatalité dont le film s’arrangera bien par la suite. Celle qui consiste à s’affranchir de toute responsabilité ou justification quant à ce qu’on va nous servir, car le pauvre Beigdave n’y peut rien , au fond: il est tombé dedans quand il était petit.
Ceci étant fait et bien torché, Beigbeder-Réalisateur s’en donne à cœur joie. L’heure et demi suivante vous proposera en substance une effusion de culs, de nichons, de bites, de nains et de vomi. Une imagerie baroque si l’on peut dire, en constante réinvention l’on aimerait croire, mais qui pourtant révèle assez rapidement sa tragique vacuité.
Pire. Sans doute Beigbeder a-t-il trop vite oublié que la provocation, même sous couvert d’un beau vernis rouge pétant, pouvait rapidement sombrer dans l’abjection la plus totale si elle n’était pas accompagnée d’un regard absolument irréprochable, en tout cas d’un regard.
La vie, la vraie…
Mais revenons rapidement à ce qu’est l’histoire du film, et ce qu’elle entreprend de raconter. Beigdave est un casteur de mannequins collaborant avec les plus grandes agences russes. L’âme égarée dans l’alcool et la luxure, il est finalement rattrapé en vol par l’une des plus grandes entreprises cosmétiques du monde : l’Idéal.
Après le scandale médiatique provoqué par l’égérie de la marque, prise en flagrant-délice de sextape à la Kim Kardashian, Octave semble être le dernier recours face à la chute d’un empire financier. Il part donc, accompagné de la directrice visuelle de la marque, interprétée par Audrey Fleurot, au fin fond de la Russie en quête d’une nouvelle égérie…
C’est ainsi que le scénario nous plonge dans une version modernisée et publicitaire du Voyage Initiatique qui, à l’issue d’une série de gueules de bois et de castings sous coke, les mènera aux confins de l’Europe de l’Est, à la rencontre des bouseux du coin. C’est dans ce cadre exotique aux accents revigorants que les personnages connaîtront une forme d’illumination qu’ils n’attendaient pas. Car finalement, c’est pas si mal la vie au grand air, loin des images, des putes et du capital.
Vous l’aurez compris : ce qui est inouï, c’est que nous tenons bien là le premier degré du film. Le voilà donc ce fameux « Idéal », généreusement déversé avec la plus grande sincérité.
Dans mon bac à snow
Il faut voir cette séquence où Audrey Fleurot, toute fraîchement accouchée et révélée à elle-même depuis qu’elle a fait son coming-out, pète soudainement un câble à l’aéroport, brûle les magazines exposés sur la devanture du kiosque à journaux, en vociférant des propos révolutionnaires sur les dangers de l’exposition aux images. La cerise, c’est de la voir cacher les yeux du nourrisson pour le préserver de toute cette putasserie, en espérant qu’il n’ait pas le même destin tragique que le pauvre Beigdave.
De la même manière, les seuls moments où Beigbeder s’essaye au registre sentimental, notamment à travers la délivrance progressive de son héros, échouent coup sur coup. Il faut dire que rarement un film sera passé si loin de l’empathie car précisément, rarement des personnages n’auront été aussi bêtes. Incapables d’exister en dehors des tirades désenchantées qu’ont leur fait réciter, chaque figure est une espèce de monstre creux, une marionnette qu’on articule et désarticule à volonté, que l’on traîne dans la boue comme un vieux jouet. Cette instrumentalisation de l’humain qui est faite ici raconte cependant une chose intéressante. Pour Beigbeder, l’usage du cinéma dans son entier n’est qu’un miroir embellissant ; une énième façon de se répandre, de rendre sa lubricité sympathique, et d’ériger à une échelle spectaculaire une pensée médiocre.
Le problème c’est qu’à un tel niveau de négligence, on se doute que Beigbeder s’en fout complètement de ce qu’il semble vouloir dénoncer. C’est en fait le service minimum permettant d’entrevoir la vraie ambition du film : celle de nous divertir, en construisant un humour graveleux sur un édifice de fesses galbées et de tétons qui pointent.
L’Idéal est au cinéma ce que la nutrition est au mannequinat : deux doigts au fond de la gorge.
Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes les news cinéma et les dernières critiques cinéma.