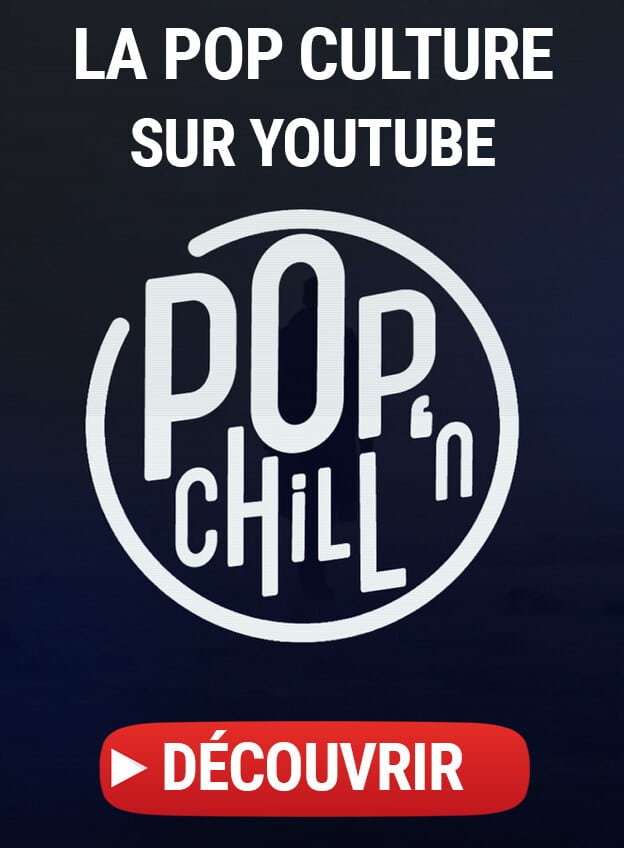Réalisé par Nick Love, American Hero est un film de super-héros aux ambitions anti-conformistes.
En réaction à…
Plutôt engageant sur le papier, le film nous met sous le nez, et ce dès les premières secondes, le cahier des charges des studios Disney-Marvel. Il semble nous dire : « Tu vois ça, je vais le brûler et le réduire en confettis. »
En effet, le programme nous est exposé comme une réaction épidermique aux collants de Captain America, lisses et proprets. On en déduira assez facilement la charge ironique du titre, qui désigne en fait le film que l’on ne verra pas.
Loin d’Hollywood
Car loin de s’attarder sur l’Amérique entière, le film trouve son ancrage dans les proportions modestes d’une Louisiane cramée par le soleil, cloisonnée dans un pâté de maisons de la Nouvelle Orléans, dont le décrépitude et la pauvreté annoncent d’emblée le goût et la couleur.
Vous l’aurez compris, nous serons bien loin des tours de verre de Manhattan, et tout aussi loin d’Hollywood.
Dans American Hero, le parti-pris réaliste adopté consiste à dépeindre une Amérique profonde et véritable, à la plus petite échelle, soucieuse de filmer ceux qui n’ont jamais de gros plan. Une vieille dame raconte alors les ravages de l’ouragan Katrina sur sa maison, l’on constate la pression des gangs dans les rues, sous le regard d’un flic impuissant, dont la bonté ne suffit plus à cacher l’usure du temps.
Plus humain que héros
Ce n’est pas un hasard si le film s’attarde en premier lieu sur l’environnement, car le (super)héros du film, interprété par Stephen Dorff, semble complètement déterminé par son cadre de vie, pour ne pas dire qu’il en est le produit.
D’ailleurs, c’est dans un tas de détritus, étalé au beau milieu d’une décharge pestilentielle que nous est présenté Melvin, à peine remis d’une cuite dont il n’a guère de souvenir. Contaminé par le vice et incapable de se projeter dans l’avenir, le personnage fait preuve d’un cynisme borné, tragiquement enraciné à des terres qu’il ne se résoudra jamais à quitter. Un accent assez rafraîchissant qui n’est pas sans rappeler, à moindre mesure, le désopilant personnage de Trevor dans GTA V.
A cet égard, c’est au travers du plan le plus emblématique du film, sûrement le plus beau aussi, que Melvin provoque le spectateur face caméra, arborant la toison à plumes d’un indien, figure native de l’Amérique, éternel ennemi symbolique également.
Ce n’est qu’un peu plus tard que le fantastique montrera le bout de son nez. Car il se trouve que Melvin est doté d’un don – la télékinésie – lui permettant de bouger les objets par la pensée.
Le film entretient un doute quant aux origines de ce don, et s’y intéressera d’ailleurs assez peu. Mutant pour les uns, envoyé divin pour les autres, ce qui intéresse davantage le cinéaste ici, c’est la question de la responsabilité.
Lucille, ancien rescapé de la guerre en Irak et meilleur ami de Melvin, a perdu l’usage de ses jambes sur le champ de bataille. Bienveillant mais quelque peu envieux, il incarne naturellement la figure du maudit, qui n’existe plus qu’à travers sa relation avec le surhomme, sur qui il peut projeter tous les rêves qu’il ne pourra jamais réaliser. Sous couvert d’un discours sur le juste et le bon, le personnage cherchera pendant tout le film à pousser Melvin sur les rails du futur super-héros. L’idée intéressante, c’est qu’au fond, le personnage n’en a cure de ces discours. Après tout, il a déjà donné ses jambes à la patrie.
De cette idée émane une forte détonation ironique à l’intérieur du film – les teintes d’humour acide sont d’ailleurs assez réjouissantes – en ce qu’il ne cède jamais rien à la tentation patriotique. Bien au contraire, les enjeux ne cesseront de se resserrer autour de l’intimité des deux personnages (Melvin et Lucille), et chaque décision, chaque élan héroïque, ne sera déterminé que par une quête bien personnelle : celle de revoir son enfant pour l’un, rêver par procuration pour l’autre.
Un peu partout… un peu nulle part…
Au delà des trajectoires pertinentes esquissées, on ne peut s’empêcher de ressentir une frustration quant à une certaine naïveté, se traduisant au fur et à mesure du film par un cruel manque d’approfondissement des thématiques.
Peut-être y avait t-il trop à faire ? Nick Love, metteur en scène inspiré mais – on va le voir – bordélique, aurait-il préféré céder à l’agitation, plutôt qu’à penser son objet ?
Film documentaire, film de super-héros, satire sociale, comédie noire, drame familial, American Hero ne fera jamais le choix de développer ne serait-ce qu’une seule de ces possibilités, lui préférant un certain fourrage écœurant.
C’est pourtant bien dommage qu’un film, qui s’annonçait comme un antidote, un pied de nez aux blockbusters boursouflés que l’on subit quotidiennement, s’entête à avancer contre les vagues, sans même voir qu’il finirait par se noyer dans les mêmes travers ; celui du cahier des charges précisément, quand bien même serait-ce « en réaction à ».
Found Footage de gueule
Cette indécision se révèle toute entière via le procédé même de mise en scène : le found footage.
Parti-pris consistant à faire exister le dispositif de caméra à l’intérieur du film (Cloverfield, Paranormal Activity – originellement Cannibal Holocost), la condition de sa réussite est déterminée par le choix d’un axe drastique. C’est un peu le cas inverse de Chronicle de Josh Trank, qui se retrouvait prisonnier du contrat formel propre au genre, sans jamais oser lui faire la moindre entorse.
Dans American Hero au contraire, le found footage n’est jamais un parti-pris assumé, mais un simple accessoire. Posé çà et là arbitrairement, sûrement pour accentuer l’impression documentaire, il est aussi évacué de l’habitacle à chaque fois que le réalisateur décide de prendre un virage trop serré.
Ça laisse à voir des passages particulièrement grotesques, où le cadreur – censé réaliser un reportage sur Melvin – se retrouve tantôt au milieu d’une fusillade sans sourciller, tantôt à s’immiscer dans des moments d’intimité extrêmes et ce, en toute invisibilité.
Ce qu’il en résulte, c’est que le film n’accepte jamais les contraintes, se refuse à toute forme de pudeur, y préférant la démonstration perpétuelle, la sur-lisibilité, ainsi qu’un goût surprenant pour ce qui se révèle être, à terme, du sentimentalisme neuneu.
En créant une arène restreinte, ainsi qu’un univers granuleux et racé, le film avait pourtant trouvé une base de singularité intéressante. Mais force est de constater qu’à vouloir retrousser le costume du super-héros pour en révéler les coutures, Nick Love réalise une œuvre étrangement cousue de fil blanc.
Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes les news cinéma et les dernières critiques cinéma.