La spirale vers le bas : Si certains chefs d’œuvre se bâtissent sur la beauté, l’originalité, le feeling musical ou le talent technique, rares en revanche sont ceux qui naissent de la souffrance. Non pas magnifiée, non pas vectrice d’inspiration salvatrice, non pas génitrice d’une mélancolie apte à provoquer l’émotion : non, une souffrance crue, brutale, répugnante.
Il est pourtant exact que certains rockers se sont déjà risqués à mettre à nu leur torture intérieure et leur dégoût d’eux-même. On pense bien sûr aux grands noms du grunge, Layne Stayley et Kurt Cobain. Le Christ Grunge n’est-il pas allé jusqu’à intituler l’une de ses chansons « Rape Me » (« Viole moi ») ? Malgré tout, personne n’a osé s’aventurer aussi loin sur ce chemin glauque que Trent Reznor et sa spirale descendante, concept album retraçant la déchéance d’un homme le conduisant irrémédiablement au suicide.
Dans l’optique d’arriver à un résultat aussi proche que possible de la réalité, le maître d’œuvre des clous de neuf pouces ne va pas par quatre chemins. Il fait construire en 1993 ses studios d’enregistrement au 10050 Cielo Drive à Beverly Hills, maison dans laquelle l’actrice Sharon Tate fut assassinée par le gourou-serial killer Charles Manson. Baptisant « Le Pig » la pièce qui lui sert de studio, Reznor s’y barricade et s’attelle à chanter et à enregistrer lui-même toutes les plages instrumentales en solo. A une exception prêt, comme toujours : les parties de batteries sont assurées par Stephen Perkins (ex Jane’s Addiction). Il n’y a que sur « Piggy » que Reznor s’essaye pour la première et la dernière fois de sa vie à malmener ses propres fûts. L’ensemble est ensuite expédié dans les entrailles d’un l’ordinateur, puis copieusement bidouillé, largement déformé et allègrement inondé de samples cultes – allant de bruits de lutte tirés du film THX 1138 de George Lucas (« Mr Selfdestruct ») aux rythmiques de basses transformées en percussion du « Nightclubbing » d’Iggy Pop (« Closer »). Par dessus le marché, c’est à Flood qu’incombe une fois de plus le mixage de la galette, lui qui avait déjà opéré de petits prodiges sur le précédent disque. A sa sortie, l’oeuvre fait immédiatement référence sur un plan purement technique, même si aujourd’hui cette production peut sembler un peu dépassée (notamment en comparaison avec les oeuvres plus récentes du maître). Et ce n’est qu’une fois l’album enregistré et mixé que l’on procède à une démolition en règle de la bicoque maudite sur le souhait des proches de la défunte actrice. Une page vient de se tourner, pour la famille Tate comme pour le rock. En effet, jamais une œuvre musicale n’est allée aussi loin dans l’exploration de la dépression mentale, à tel point qu’elle en est arrivée à infecter son géniteur : Trent Reznor s’est en effet tellement investi dans ce concept album, il a si bien réussi à retranscrire ces sensations étranges et infâmes liées à la maladie qu’il a lui-même fini par y succomber quelques mois plus tard. Le mal l’a rongé durant presque dix ans et a semble-t-il failli avoir sa peau.
Ça, c’était la petite parenthèse : « Quand la fiction rattrape la réalité »… mais poursuivons. Si l’ensemble du disque est écrit à la première personne, on s’aperçoit très vite que trois narrateurs différents se succèdent dans le récit : l’homme sain, l’homme malade et la maladie elle-même. « Mr Selfdestruct », par exemple, se tient du côté de la maladie, appréhendée comme une entité extérieure qui corrompt insidieusement l’esprit de l’homme en souffrance. A la manière d’un Chuck Palahniuk (on vous renverra au cultissime Fight Club pour illustrer le propos d’une autre manière), Reznor personnalise cette entité et lui donne la parole : « Je suis la voix à l’intérieur de ta tête, et je te contrôle ». Changement de point de vue dans « Piggy » : là, l’être tourmenté se rend compte que son esprit est en train de se disloquer, et la parcelle d’humanité qui reste encore vivace en lui tente d’entrer en contact avec son moi malade. L’incompréhension que ressent l’homme face à cette étrange sensation de noirceur et de désespoir le pousse à brutaliser la partie ébranlée de son être : automutilation physique dans le titre précédent, et brimades psychologiques dans ce morceau où il se qualifie lui-même de porc. Cette image porcine, dans ce que l’animal a de sale, de laid et de stupide, devient un leitmotiv récurrent tout au long du disque, tant au sein des paroles que dans les samples couinant qui suintent des titres. Certes l’homme tente de résister : rébellion contre un Dieu incapable de le sauver (« Heresy »), rejet d’une humanité abhorrée et avilie (« March Of The Pigs », confondant de misanthropie), embrassement de la luxure dans ce qu’elle a de plus abject (« Closer » : « Tu me laisses te violenter, tu me laisses te pénétrer, je veux te baiser comme un animal », le fait de sentir – ressentir la douleur – la jouissance sexuelle étant le dernier élément qui permette de maintenir en vie cet individu privé de son équilibre psychique), sublimation de la violence aveugle (« Big Man With A Gun ») ou encore rêve d’omnipotence fantasmée (« I Do Not Want This »). L’auditeur notera au passage la crudité phénoménale du langage, et encore on vous épargne les sorties les plus allumées. Petit à petit, la révolte qui anime l’homme fait place au désespoir puis à la résignation (excellemment bien retranscrite dans l’instrumental « A Warm Place »), pour aboutir au suicide implicitement évoqué dans l’horrible « The Downward Spiral ». Initialement, Reznor voulait aller plus loin dans ce thème et traiter de la conduite suicidaire d’une manière beaucoup plus aiguë : il avait composé et enregistré un titre appelé « Just Do It », dans lequel il faisait dire à la maladie : « Si tu veux te tuer, vas-y, fais le, tout le monde s’en fout », mais c’est Flood qui a mis le holà, ne voulant pas être impliqué dans une chanson aussi extrémiste qui aurait pu, et on le comprend bien, pousser au passage à l’acte un bon nombre de dépressifs.
Rien qu’à l’écoute des samples introductifs de « Mr Selfdestruct », bruits de coups que l’on devine auto-infligés et cris de douleur frénétiques, on sait pertinemment que l’on n’a pas affaire à une œuvre conventionnelle. D’ailleurs, si Broken (le précédent EP) était déjà qualifié par la critique de manifeste violent, cet album-ci se révèle pour sa part d’une agressivité proprement hors normes. Non content de pousser à son paroxysme les technologies mises à sa disposition pour instiller toujours plus de bruitages de machines dans ses titres, non content de les truffer de boucles sonores plus bizarres et tordues les unes que les autres, non content de déstructurer totalement ses chansons en un chaos de thèmes savamment orchestrés, Reznor en profite pour explorer dans ce disque les contrastes les plus extrêmes. La voix de Nine Inch Nails, tranchante comme une lame sadique, exhibe alternativement rage, haine, dégoût, frustration et affliction en un torrent de lave brûlante, les hurlements bestiaux de l’homme succédant à son chant convulsif, son rap poisseux ou son slam purulent. On trouve des morceaux proprement hallucinants sur cette galette : « Mr Selfdestruct« , le titre le plus brutal de Reznor (tous albums confondus), littéralement déchiqueté par des scies circulaires démentes et irrépressibles ; « Piggy », trip hop mortifère haletant de noirceur ; « Heresy« , dance-rock binaire aussi jouissif qu’asphyxiant ; « March Of The Pigs », techno spasmodique piétinant sauvagement nos tympans ; « Closer« , peut-être l’ode pop la plus malsaine jamais créée par un être humain ; ou encore l’extraordinaire « Hurt », éprouvante mise à nu psychique d’un être totalement dévasté et seul titre du lot à générer chez l’auditeur une compassion sans réserve. Il ne faut bien sûr pas oublier les sirènes apocalyptiques de « Ruiner« , la furie électronique de « I Do Not Want This« , le rock opaque et enfiévré de « Big Man With A Gun« , les martellements d’enclume démoniaques de « Eraser« , ou encore les expérimentationss indus barrées de « The Becoming« , entre bruitisme déglingué, acoustique rassurant et pilonages à la rotative lourde. Au milieu de l’album, un surprenant titre doux et calme, « A Warm Place », répit avant une fin suicidaire. Notez le refrain déchirant de « Reptile », écrasante déclaration d’amour contre-nature et aveu d’impuissance sourde face au mal qui ronge l’être avili : « Oh ma belle menteuse, oh ma précieuse putain, ma maladie, mon infection, je suis si impur ». Un bon résumé de cet implacable bréviaire de mort, aussi époustouflant de puissance évocatrice qu’effrayant de justesse dans le propos.
The Downward Spiral représente la pièce maitresse du mythe Nine Inch Nails, tout comme l’objet d’une adoration sans borne vouée par des pointures comme Marilyn Manson, David Bowie ou Axl Rose. Son caractère outrancier et nihiliste est apte (au choix) à fasciner, intriguer ou révulser, mais il ne peut laisser personne indifférent. Un album forcément culte qui dévoile, au fil des écoutes et malgré ses ignobles orripeaux de douleur, une beauté aussi perverse que repoussante. En gommant toute émotion de cette galette pour nous présenter la souffrance dans toute sa crudité, Reznor a peut être accompli l’oeuvre artistique la plus inhumaine qui ait jamais été conçue. La chair sans l’esprit n’est décidément rien.


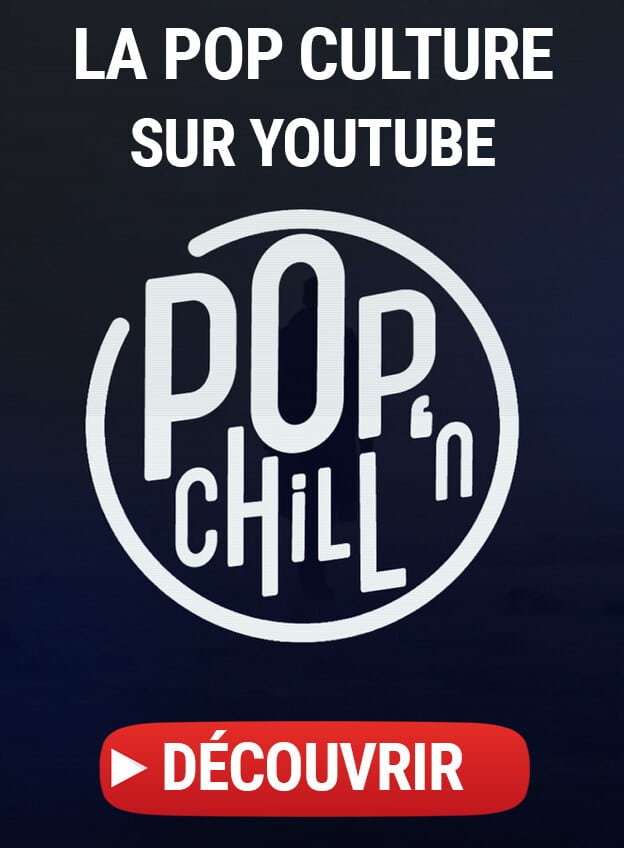




A la fois terrifiant et déchirant ! Quelle expérience !
L’une des ultimes preuves que le divin et la bête sont liés, et s’influencent l’un l’autre. La spirale infernale de l’être humain.