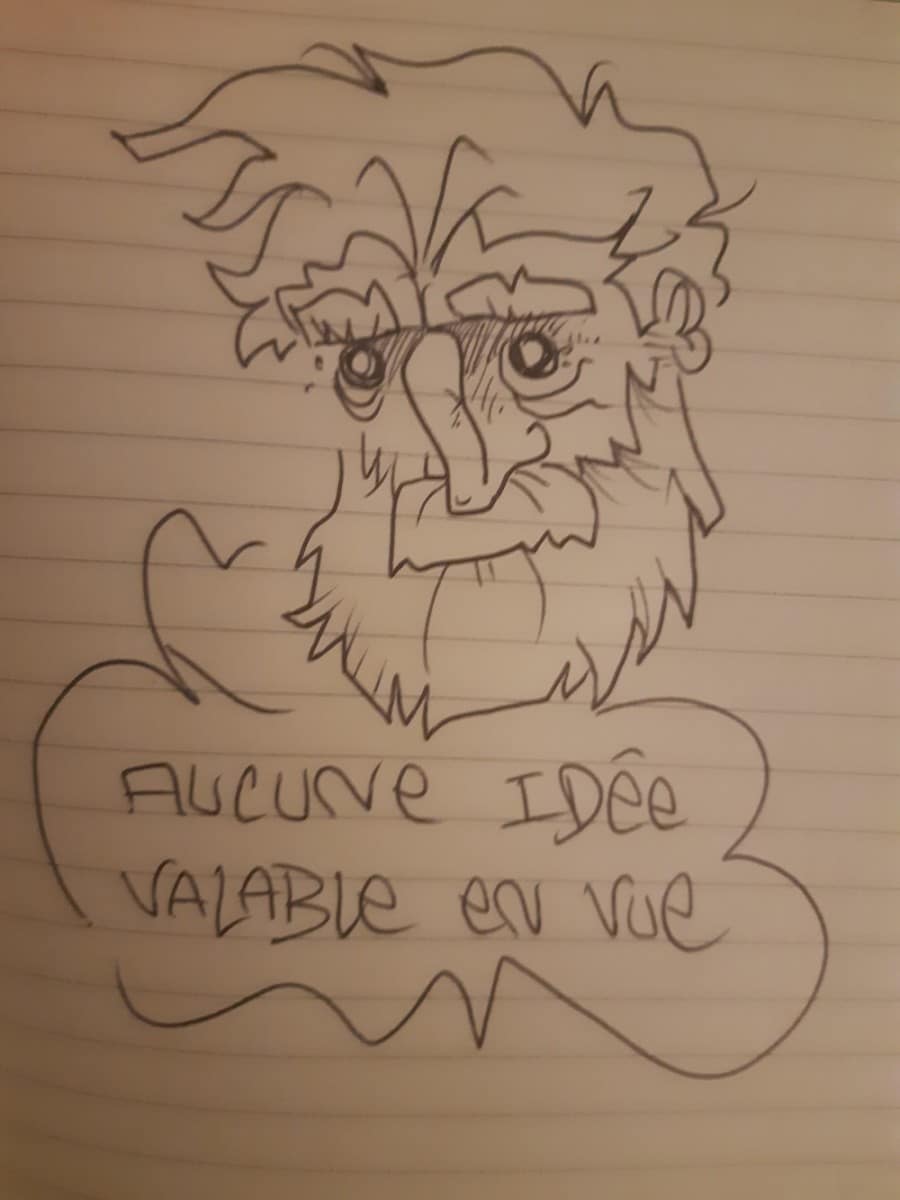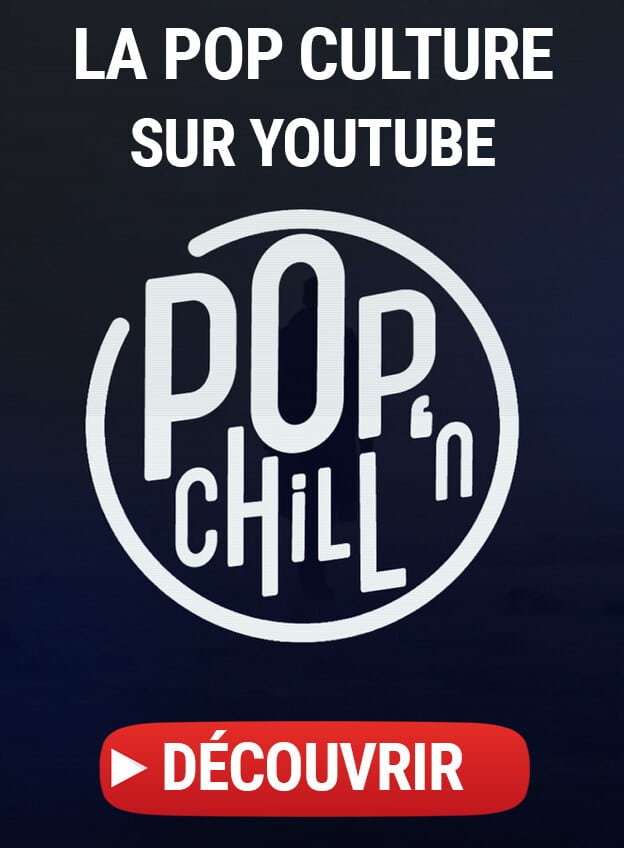Laissons les tendances de côté et intéressons-nous à l’originalité. Avec Adopte un Créatif, vous allez découvrir des passionnés, des créatifs, des youtubeurs / youtubeuses méconnu(e)s qui font l’actualité du web. Pour ce nouveau numéro, je suis parti à la rencontre de Geoffrey Crété et Simon Riaux du site Ecran Large.
C’est un numéro spécial aujourd’hui. A travers cette chronique, j’ai l’habitude de mettre en lumière des créatifs en tous genres. Des blogueurs, des rédacteurs, des créateurs de contenus sur les réseaux sociaux ou encore des Youtubeurs. L’idée de départ de la chronique est de partir à la rencontre des différents talents du web, qui ne sont pas forcément dans les tendances. Des créatifs chez qui on retrouve la passion, la vraie, l’envie de partager avec les autres.
Nous avons également des créatifs et des passionnés derrières certains médias connus de tous. Depuis plusieurs mois, je réfléchissais à l’idée de partir à la rencontre des rédacteurs de ces médias et notamment de Geoffrey Crété et Simon Riaux. Si vous êtes un.e féru.e de l’actualité cinéma vous les connaissez très certainement. Ils officient tous les deux sur le site Ecran Large.
Habituellement, quand un site a une thématique cible c’est très rare, pour ne pas dire jamais, qu’il consacre un papier à un autre média sur la même thématique. Ce n’est pas ma manière de fonctionner, bien au contraire. EL est l’un des rares sites français que je consulte régulièrement. J’apprécie le ton et la diversité des contenus. S’il m’arrive de ne pas partager leur point de vue sur un contenu, l’argumentaire est toujours intéressant et j’avoue être un immense fan des célèbres punchlines de Simon. Aussi, depuis quelques mois, nous sommes nombreux à avoir remarqué ‘un second souffle’ au sein de leur rédaction, notamment avec la création de contenus vidéo. C’est pourquoi je trouvais pertinent de consacrer un numéro d’Adopte un Créatif à Geoffrey Crété et Simon Riaux.
Dans cette interview croisée, nous évoquons leurs parcours respectifs, l’actualité des salles et des plateformes de streaming, le genre héroïque, le Snyder Cut, Hollywood et la ligne éditorial du site. Le tout saupoudré avec les petites notes d’humour de Simon.
Rencontre avec les Tango & Cash de l’actualité cinéma.
Bonjour Geoffrey, Simon, merci d’avoir accepté mon invitation pour la chronique ‘Adopte un Créatif’. Dans le cas où il y aurait des internautes ignorant votre actualité, pouvez-vous vous présenter et nous rappeler votre parcours ?
Geoffrey : Je suis le rédacteur en chef d’Ecran Large. J’ai fait la même école de ciné que Simon, et on se détestait déjà à l’époque. On s’est donc dit que ce serait drôle de subir une cohabitation dans la même boîte. Avant Ecran Large, et après mes études, j’ai mis un orteil sur les plateaux de tournages, dans la déco, la régie, l’assistanat. Ensuite, j’ai commencé à écrire pour quelques sites : j’ai débuté sur DVDrama (rapidement racheté par TF1, et renommé Excessif), et je suis passé par Webedia (expérience fascinante dans la presse people, parce que Mimi Marchand était dans le coin, et que depuis elle est devenue une star grâce aux Macron). J’ai aussi écrit des articles pour quelques autres médias, dont UGC illimité et Tecknikart (qui ne m’a jamais payé d’ailleurs).
Simon : Après (un peu) d’études de lettres, portées par le désir d’être enseignant, j’ai compris que poursuivre dans cette voie m’exposerait à assassiner un contingent non-négligeable d’élèves, ou de professeurs. J’ai donc tenté le concours de l’ESEC, que j’ai rejoint, pour suivre la section production audiovisuelle. Ce fut l’occasion de rencontrer Bruno Hodebert, qui était le référent pédagogique de cette option et le directeur des études. Sa bienveillance et son parcours m’ont pas mal aidé, non seulement à voir clair dans ce qui ne ressemblait pas encore tout à fait à un projet, mais aussi à y réinjecter de la curiosité, à un moment assez particulier, ou, entre la professionnalisation d’un domaine auparavant placé sous l’égide de la passion, l’arrivée à Paris et la confrontation avec un environnement radicalement différent de ce que je connaissais jusqu’alors rendait l’adaptation, ou à tout le moins la sérénité, difficile.
Geoffrey, en 2008 tu obtiens ton diplôme d’assistant réalisateur de l’ESEC. Dans la foulée, tu participes à différents projets ‘Un village français’ sur France 3 et ‘Paris 16’ pour M6. Quels souvenirs gardes-tu de ces deux expériences ?
Geoffrey : Super souvenirs pour le puceau des tournages que j’étais. Sur Un village français, c’était un tempo très particulier : la déco bosse loin du plateau, prépare les prochains décors, et s’en va quand toute l’équipe arrive pour filmer. Mon premier tournage, c’était plusieurs mois à 100km du tournage. On investissait des lieux fantomatiques avec une tonne de planches, de meubles, d’accessoires.
Je me souviens avoir rempli des sacs de livres parce qu’on tournait dans une vieille bibliothèque qui allait les jeter. C’était le truc le plus triste du monde de les voir attendre les poubelles. Et surtout, je garde le souvenir du chef déco François Chauvaud et son frère Jean-Luc, qui sortaient du carton Les Choristes. De sacrés caractères, des gens adorables, passionnés, méticuleux. Ils m’ont même offert un iPod pour mon anniversaire sur le tournage, c’était dingue pour moi.
Paris 16, j’en garde surtout un grand souvenir humain. Cette série, c’était du n’importe quoi, très symptomatique de la production TV française – et si on lançait direct 80 épisodes, sur un scénario basique de mauvais soap, et à peu près zéro ambition visuelle ? C’était quasi intégralement en studio, j’étais la dernière roue du carrosse mise en scène, donc rien à voir avec Un village français. Et ça a été un tournage magique, grâce à l’adrénaline de l’équipe mise en scène… et à l’énergie des soirées. Pensée pour Eugénie, parce que c’est grâce à elle que je me suis retrouvé là, et c’est devenu une amie proche. C’est ça aussi la fameuse magie des tournages.
Ensuite, tu officies comme assistant régie sur plusieurs épisodes de ‘X femmes’, la série érotique et anthologique de Canal+. Comment es-tu arrivé sur ce projet ?
Geoffrey : Encore une amie, Marie, qui bossait déjà dessus. Comment dire non à un projet de courts-métrages pornographiques féministes, réalisés par des femmes ? Là encore, belle expérience. Je me souviens que Mélanie Laurent, qui réalisait l’un des courts, a été castée dans Inglorious Basterds pendant la prépa, donc on a vu de loin ce grand moment. J’ai aussi pu boire une bière en face d’un sex shop avec Zoe Cassavetes, une autre des réalisatrices.
J’ai pu lui dire que j’adorais Parker Posey, qu’elle avait dirigée dans Broken English, c’était mon petit plaisir cinéphile. Je me souviens aussi et surtout de la productrice Sophie Bramly, une femme brillante, impressionnante, extrêmement gentille, mais assez intimidante vu son parcours. Et puis bon, j’ai bossé sur des porno. Forcément ça laisse des souvenirs, intéressants disons.
En 2014, après un court-métrage co-réalisé avec Clémentine Isaac, tu réalises Axiome, un court-métrage de science-fiction. Peux-tu nous pitcher le projet ?
Geoffrey : C’est un long court-métrage de SF-dystopie. C’est l’histoire d’un garçon né avec des anomalies : il a un handicap à la jambe, et une étrange marque sur sa rétine. Il se sent incomplet, et cherche un sens à son existence. Jusqu’au jour où l’humanité découvre une forme de vie extra-terrestre microscopique, qui est identique à ce qu’il a gravé dans son œil. A partir de là, il va voir que les gens autour de lui commencent à changer, et que quelqu’un ou quelque chose le poursuit.
Quelles ont été tes influences pour Axiome ?
Geoffrey : La parano de L’Invasion des profanateurs de sépulture, la mise en scène de Shyamalan sur Signes, et l’étrangeté mélancolique de Richard Kelly.
Simon, que penses-tu de Geoffrey en tant que réalisateur ?
Simon : C’est très difficile de répondre à cette question. Pas seulement parce qu’il va me lire, mais parce que, sitôt qu’on passe un tant soit peu derrière l’écran, dans les coulisses, pour produire, pour écrire, pour réaliser, pour interpréter, pour partager un exercice critique, le sens de certains mots diffère, tout comme la nature de l’expérience. Je suis parfaitement incapable d’appréhender Geoffrey comme réalisateur, ou comme un pur objet abstrait de mise en scène.
En revanche, ce que je vois, ou plutôt ce que je sens, qui est à la fois passionnant et rassurant (à mes yeux), c’est l’impression de ressentir devant son travail une expression très cristalline de Geoffrey. De son rapport au monde, fort et intéressant parce que paradoxal, ou toujours nuancé au bon endroit. Volontaire sans être violent, stimulant sans rouerie, au style suffisamment assumé pour brandir le bizarre. Le Geoffrey réalisateur ressemble au Geoffrey que je connais, ou à ce que je perçois de lui.
Il me semble que tu prépares d’autres projets. Un drame qui se déroulerait dans le sud de la France et plusieurs scénarios d’horreur. Peux-tu nous en dire plus ?
Geoffrey : Le drame, c’est un long-métrage, donc autant dire que j’ai le temps d’avoir les cheveux beaucoup plus grisonnants avant qu’il se concrétise. Tant mieux, il mérite des réécritures et plus de maturité vu le sujet. En revanche, je développe activement un court-métrage d’horreur-fantastique féminin, avec une touche de médiéval, que j’ai écrit et compte réaliser. Il s’appelle pour l’instant Ava, et Michael Proença m’accompagne, avec sa boîte Wild Streams.
Simon, tu es également diplômé de l’ESEC avec plusieurs expériences dans l’assistanat de production et de décoration. Peux-tu nous parler des différents projets sur lesquels tu as travaillé ?
Simon : Publicités, clips et pilotes de série, aussi excitants que dépaysants, puisque les deux années où j’ai officié comme assistant de production en plateau et assistant déco sont nées d’un quiproquo. Je suis arrivé en prépa d’un long-métrage auto-produit et joyeusement fauché, affilié à la machinerie par un assistant de production manifestement aussi manuel que moi.
D’un tournage parfaitement surréaliste en Auvergne ont découlé de très jolies rencontres et deux années de travaux aux postes mentionnés ci-dessus. Autant d’expériences plutôt passionnantes et surprenantes.
On t’a également vu comme chroniqueur dans l’émission ‘Le Cercle’ de Canal +. Ça te manque de ne plus pouvoir partager ta passion à l’écran ?
Simon : Alors, ce n’est pas seulement que ça me manque, c’est que ça me ronge le cerveau. Le Cercle a cela de très beau d’avoir réussi l’assemblage d’un groupe à la fois suffisamment bienveillant pour que chacun ait une immense confiance en ses compagnons d’armes, et suffisamment malicieux pour générer une très belle électricité en plateau. Avec pour résultat un collectif qui permet à chacun de se trouver des moments de passion et de partage très forts, rendus possibles par une addition d’empathie. Chacun y est mis en avant, par la communauté de tous.
Un plaisir retrouvé avec les nouveaux contenus d’Ecran Large ?
Simon : Un plaisir conjugué, plus que retrouvé. C’est une mécanique très différente, de se lancer au sein d’un plateau, d’un groupe, sous l’égide d’un présentateur, et de s’exprimer seul face caméra, ou en duo. Je serais même tenté de dire qu’exception faite de la caméra elle-même, c’est une pratique fondamentalement différente, qui réclame une mélodie, un rapport à soi, à son expression, qui n’ont que peu de choses à voir avec celle d’une émission en bande.
Il est nécessaire, pour être pertinent et s’y amuser, de trouver sa mélodie, son tempo, son terrain de mise en danger, ce déséquilibre qui oblige à trouver ce grand écart entre équilibre et véritable lâcher-prise, mais je pense que c’est cette tension qui constitue l’unique point commun entre les deux.
Diriez-vous qu’il est nécessaire d’avoir votre formation et votre expérience pour parler de cinéma ?
Geoffrey : Oh que non. Ecran Large en est, j’espère, la meilleure preuve. Dans l’équipe, on a des gens qui ont une pure formation de journaliste, qui sortent d’une école de cinéma comme nous, ou de la fac, avec une approche cinéma ou plus largement artistique.
Certaines personnes écrivent et réalisent des projets, d’autres sont uniquement intéressées par une approche théorique, et n’ont jamais mis les pieds sur un plateau. Ce n’est pas un accident : on cherche de la diversité dans les parcours, même si ça reste relatif, et que c’est tout sauf simple vu le petit site qu’on est. Ce qui compte, c’est la passion, le point de vue, la sensibilité, et la soif de découvrir, réfléchir et écrire. C’est la seule formation qui compte, et elle ne se fait pas simplement dans les amphi.
Simon : Il est nécessaire de se former, et d’entamer une expérience (qui demeurera par définition, perpétuellement inachevée), mais il n’existe pas de formation évidente, de voie royale, ou de déterminisme excluant. Parler du cinéma réclame d’être exigeant avec soi-même, de régulièrement se confronter aux styles, aux chapelles ou aux écoles qu’on récuse, pour mieux comprendre sa défiance, ou pour l’abattre, de toujours envisager sa pratique comme un partage plutôt que comme un don, comme une transmission qui nécessite une réciprocité. J’ai tendance à croire que se confronter au classicisme et à la culture académique demeure indispensable, surtout si on prétend les battre en brèche.
Mais ce n’est pas une question de formation, ou d’expérience professionnelle. C’est histoire de curiosité et d’appétit.
Quelle est votre définition de la cinéphilie ?
Geoffrey : C’est vouloir et pouvoir discuter, même si (et surtout si) on n’est pas d’accord sur une œuvre ou un.e artiste. Parce que le dénominateur commun entre les cinéphiles, ça restera la passion, et le besoin de voir et revoir et réfléchir et découvrir et partager. Donc la cinéphile, en tout cas celle qui me plaît et qu’on défend sur Ecran Large, ce n’est pas s’autoproclamer juge de la bonne ou mauvaise cinéphilie, hiérarchiser les genres et les gens, alimenter les guerres de camps et bloquer les échanges avec tout un tas d’étiquettes qui réduisent les personnes, parce que c’est plus simple que de débattre.
Simon : Un cinéphile, c’est quelqu’un qui mange et boit beaucoup, et a une idée arrêtée de ce qu’est un mauvais cinéphile. Sinon, c’est quelqu’un qui n’arrive pas à s’endormir devant un long-métrage qu’il n’a jamais vu.
Qu’est ce qui vous a donné cette vocation ?
Geoffrey : Je dirais qu’il y a eu trois paliers. Le premier, c’est quand je me posais devant la TV pour regarder Aliens le retour ou Les Oiseaux, avec ma mère. Pas de cauchemar, juste une immense fascination. Le deuxième, c’est quand j’ai découvert Scream 2, qui m’a passionné et m’a ouvert plein de portes (Wes Craven bien sûr, mais aussi Gregg Araki, via Rose McGowan dans le premier Scream).
Le troisième, c’est l’option cinéma audiovisuel de mon petit lycée en Mayenne. Là, j’ai vu Pierrot le fou, et tant pis si c’est cliché mais voir Belmondo et Anna Karina quitter Paris, et comment Godard filme ça… un choc. Là, je me suis dit : ok, le cinéma c’est pas juste pour me divertir. Il y a un truc supérieur, absolu, que je veux comprendre, et faire.
Simon : Je ne sais pas. J’ai le sentiment que ma seule vocation, c’est plutôt celle du conteur, qui me paraît tout à fait compatible avec le rôle du critique, et qui me vient à la fois d’avoir assisté, tout môme, à des contes chantés dans une bibliothèque de Cosne sur Loire, et d’avoir toujours ressenti la joie profonde qu’engendrait chez moi le fait de raconter.
Cette équation s’est incarnée dans le cinéma et son partage, mais ne s’y limite pas.
Quelle est votre toute première expérience avec internet ?
Geoffrey : On dirait un mauvais téléfilm (ou le pilote de Paris 16 tiens), mais à mon arrivée à Paris, à 18 ans. Là, j’ai eu internet, dans ma chambre étudiante, et ça a été un puits sans fond. Boulimie totale de films et séries, à un niveau totalement ridicule avec le recul. Donc ma première expérience a été celle de la consommation frénétique, sept jours sur sept.
Pour ce métier, ma première expérience marquante a été la critique de Solomon Kane, en 2009, sur DVDrama. J’ai eu droit à mes premiers commentaires énervés, insultants et enragés. Parce que je trouvais que c’était une merde. Ça a été un petit choc ces réactions. Que j’étais naïf…
Simon : On n’avait pas d’ordinateur chez moi, donc, même si j’avais lu et entendu deux trois bricoles chez moi ou dans des journaux, Internet, c’était un truc profondément abstrait. Et puis, en troisième, le grand frère d’un copain est arrivé devant nous, fier comme un paon, pour expliquer qu’il avait piraté le premier Spider-Man de Sam Raimi, que j’ai donc dû voir dans une résolution inférieure au nombre de boutons que j’avais sur le visage.
Ce fut mon premier contact avec Internet, le fondement d’une méfiance profonde avec l’idée de l’instantanéité, et la certitude que dieu était forcément mort, pour avoir laissé un grand frère prognathe me flinguer la découverte de Spider-Man sur grand écran.
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Geoffrey : Comme créatif, je dirais Bertrand Blier, Gregg Araki, Richard Kelly, Vincenzo Natali, Robert Altman, Lars Von Trier, Shane Carruth, Todd Solondz, Aaron Sorkin, Jacques Tati, Alan Ball, Charlie Kaufman, Lovecraft et Trent Reznor.
Simon : C’est à peu près toujours la littérature, que je tiens pour l’art suprême, ou plutôt l’art premier. Celui qui nécessite le moins de matériaux et engendre dans notre esprit la plus viscérale matérialité, en plus d’être un outil d’émancipation surpuissant. C’est l’art qui provoque et génère en moi le plus d’images, de zones de liberté, de ruptures, et dont je retire les émotions, les couleurs, qui me poussent à écrire, mais aussi à penser le cinéma.
Pensez-vous que les salles de cinéma sauront faire face aux plateformes de streaming ?
Geoffrey : Je vais déjà commencer par une évidence : je ne sais pas. C’est important, je pense, de le rappeler, parce qu’il suffit de parler à des collègues, des exploitants ou regarder les stratégies des studios pour se dire que visiblement, personne ne sait. Et c’est pas grave de ne pas savoir et ne pas la jouer expert ou medium.
Cela dit, je pense que les deux coexisteront, et que la vraie question est plutôt de savoir quels genres de films continueront à être exploités en salles, et lesquels seront réservés à la SVOD. Le fossé va t-il se creuser et devenir infranchissable pour certains ? Les premières victimes de cette situation, de cette concurrence qui devient parfois une guerre, ne sont pas les grosses productions. Donc je me demande quelles répercussions tout ça aura, à long terme, sur l’écosystème, et la variété des œuvres. N’oublions pas que la fréquentation des salles de ciné françaises était en progression avant la pandémie, en 2019 c’était une année quasiment record, donc il y a un public. Même s’il y a Netflix et compagnie. Et même si ce public a peut-être tendance à se concentrer sur certains films, de plus en plus…
Simon : Faire face, oui, assurément. Mais faire face comment ? Retrouver la répartition des forces d’avant la crise sanitaire ? Cela semble peu probable, d’autant plus que ces quelques mois ont sensibilisé un nouveau pan des spectateurs à la question de la chronologie des médias, qui leur paraît absurde. D’autant plus absurde que quand bien même les grands acteurs de l’industrie se concertent pour l’amender, on n’aborde jamais la question que sous son angle actuel : resserrer ou dilater les fenêtres d’exploitation. Or, c’est bien la question de permettre plusieurs types de fenêtres, de parcours, qui se pose.
Les salles survivront, et survivront solidement, à deux conditions. Premièrement, que le législateur assume que l’environnement économique du cinéma est fondé sur l’interdépendance entre différents formats et usages, et que laisser l’un d’entre eux écraser les autres serait mortifère pour le secteur économique, et pour notre rang culturel. Mais il faut aussi se poser la question de rendre la salle désirable au plus grand nombre. Pour de plus en plus de spectateurs, le cinéma est un lieu dont le confort est discutable, dont le prix est prohibitif et dont la programmation est aussi désirable qu’un banana split au Prozac.
Que pensez-vous de la multiplication des plateformes de streaming ? Selon-vous vont-elles perdurer dans le temps ?
Geoffrey : Je dirais que tout est possible. Personne n’imaginait que cette guerre du streaming allait démarrer aussi vite, avec tant de milliards jetés de tous les côtés, et un tel enthousiasme du public. On est encore dans l’œil du cyclone, avec beaucoup d’inconnus dans l’équation : HBO Max commence à peine, Paramount+ arrive bientôt…
On a déjà assisté au crash de Quibi et au décollage spectaculaire de Disney+, en quelques mois. En France, on n’a pas cette habitude d’abonnement multiples, mais aux USA, on peut être abonné à HBO, Showtime, Starz etc. Et comme le marché américain est une priorité pour ces plateformes… pas sûr que la question soit si importante que ça au fond.
Je me demande surtout ce qui se passera après la première phase (celle où on claque des milliards pour lancer la plateforme, se payer des talents et lancer de gros contenus), quand il faudra commencer à trier et gérer les succès et échecs. Vu comment Netflix continue à dépenser beaucoup, cette course sans fin ne risque pas de se calmer, en tout cas pour les gros acteurs de la SVOD – parce qu’il y aura sûrement d’autres « victimes », comme Quibi. Je me demande aussi comment on va tous gérer le flou total sur les chiffres de la SVOD, qui arrange bien le département marketing des firmes – mais bloque toute analyse ou décryptage.
Simon : Les utilisateurs ne pourront pas multiplier les abonnements, mais cette question me paraît totalement artificielle. Personne n’a jamais pu se payer TOUTES les séances des nouveautés de la semaine. Ou faire quotidiennement 60km pour accéder au cinéma le plus proche. Cette problématique me paraît d’autant plus sophistique que pour le prix de la plus modeste des plateformes, le spectateur a accès à une programmation autrement plus vaste que ce que permettait hier une petite salle de cinéma.
Pour autant la question du modèle économique de ces plateformes se pose. Actuellement, elles fonctionnent grâce à une capitalisation boursière qui a des airs de bulle, à des service tiers, ou à leur digestion par de giga-groupes qui les transforment en produit d’appel supposément rentables.
La question véritable, c’est celle, dans l’hypothèse d’une déflation des salles, de la raréfaction voire de la disparition des blockbusters, de leur capacité à créer de l’évènement, de l’engouement, de l’électricité, autour de leur modèle et de leur mode de consommation. A l’heure actuelle, les plateformes sont parfaitement incapables de vivre sans les salles. Elles ont besoin de leurs auteurs pour faire des coups, de leur crise pour acheter en masse, et de ce qu’elles ont produit pour grossir leur catalogue. Qu’en sera-t-il et qu’en serait-il si elles asséchaient le puit de pétrole qu’elles siphonnent actuellement ?
Quel regard portez-vous sur le cinéma français ?
Geoffrey : Je pense que critiquer « le cinéma français » est aussi inintéressant que de parler du « cinéma d’horreur » ou « des films d’auteur » comme un tout. Sauf à parler du système économique français, et donc de pur business, tout mettre dans le même sac n’amène pas grand-chose. Le résumer aux comédies avec Dany Boon ou Philippe Lacheau, c’est comme résumer le cinéma américain à Marvel et Adam Sandler. C’est la face émergée de l’iceberg, donc le punchingball parfait.
Comme ailleurs, il y a de tout et n’importe quoi en France. Chaque année on peut tomber sur plein de choses étonnantes, audacieuses, voire géniales, qui sortent des cases. Il faut simplement vouloir et pouvoir les voir. Et c’est là le vrai problème : le système français privilégie encore certains genres (comme la comédie, les drames sociaux), par tradition, notamment côté CNC. Et aussi parce que c’est le signal envoyé par le public dans les salles. Peu importe ce qu’on en pense, des gros films comme Le Chant du loup, L’Empereur de Paris, Dans la brume… auraient pu aider d’autres projets du genre à exister. Et montrer que le public était partant. Je pense aussi Comment je suis devenu super-héros, attendu en 2021.
Quand de tels films marchent finalement mieux à l’étranger que chez nous, je me dis que c’est symptomatique. Le cinéma de genre l’illustre parfaitement : on sait que même avec un très bon scénario, les producteurs et les distributeurs ont peur de se lancer. Un réalisateur m’a même raconté qu’on lui avait dit, « Ton scénario est super, et si c’était un film coréen, ça marcherait, on saurait comment le placer. Mais en français, non ». Je ne jette pas la pierre aux distributeurs et producteurs, ni au public. Je dis juste qu’il y a un problème plus large.
Prenons un cas de film d’horreur français : c’est un risque par principe, donc il aura un budget réduit, donc l’équipe devra sûrement faire de grosses concessions artistiques ; le budget promo sera limité, et comme les gros médias s’intéressent peu au genre (sauf s’il y a un visage très reconnu), il sera quasi invisible ; le film sera diffusé sur peu d’écrans, donc quasiment inaccessible hors Paris et grandes villes. Ce public chanceux hésitera sûrement, par peur que ce soit pas à la hauteur d’un film de genre étranger, et le mauvais score au box-office confirmera que c’est bien un risque. Çà se mord la queue. Et difficile d’y voir une issue réelle sur le long terme, à part quelques mini boosts comme au début des années 2000 (les prod Bee Movies, ou French Frayeur chez Canal), ou récemment avec Grave.
Simon : On entend que le cinéma français est mauvais. C’est un assez bon thermomètre pour repérer les gens qui ne le regardent pas, ne le connaissent pas, ne s’y intéressent pas, mais palpitent mollement pour des produits désincarnés venu des États-Unis, qu’ils jetterait avec l’eau du bain si on leur présentait comme français.
Il y a en France une détestation profonde d’un cinéma qui est perçu à la fois comme une orgie beauf à destination des prime times des grandes chaînes jadis hertziennes, et de l’autre comme un véhicule de domination de classe. Il y aurait une comédie méprisant le peuple pour le peuple et de l’autre côté, une sorte de lion’s club crapoteux du cinéma d’auteur, financé par les petits copains pour qu’on s’y rende comme à la messe entre cousins aux pieds palmés remontant les rigoles de champagne avarié depuis les fin fonds de Saint Germain des prés.
A bien y regarder, ces deux clichés sont vrais. Mais ils ne représentent qu’une proportion ridicule de ce qui se produit en France. Nous avons un des paysages cinématographiques les plus divers, vifs, créatifs, atypiques, du monde entier. Un paquet de pays rêveraient d’avoir un système de protection, d’encouragement et de financement tel que le nôtre. Certains, comme la Corée, l’ont d’ailleurs dupliqué. Avec succès.
Diriez-vous que Zack Snyder est un auteur ?
Geoffrey : « Auteur » n’a pas un sens figé et repose largement sur la sensibilité, donc oui, sans aucun doute. Je pense qu’il y a aussi une confusion parfois entre reconnaître l’auteur, et l’adouber. Zack Snyder a des thématiques, des obsessions, une identité forte. On peut avoir envie de se crever les yeux devant ses films, mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir une cohérence. Donc oui.
Et si la question sous-jacente, c’est de savoir s’il peut exister des auteurs dans les blockbusters, et les films de super-héros, alors c’est un oui sans aucune hésitation.
Simon : Bah quand un studio en est à baptiser un film du nom de son réalisateur (coucou Zack Snyder’s Justice League), à priori, c’est un auteur.

Justement, récemment nous avons pu voir le Zack Snyder’s Justice League. Etes-vous d’accord pour dire qu’il fallait le laisser terminer son arc de cinq films ?
Geoffrey : Ce qui est sûr, c’est qu’on en avait envie, parce que c’est ambitieux et excitant. Après, est-ce qu’il « fallait »… Justice League a été fait au cœur du système des studios, donc c’est largement un business avant d’être du cinéma. Ce n’est pas la première ni la dernière fois que ça arrive, même si le cas du Snyder Cut est unique.
Sinon, à ce compte, je pense qu’il « fallait » qu’un studio finance Les Montagnes Hallucinées réalisé par Guillermo Del Toro, produit par James Cameron, et avec Tom Cruise. Il « fallait » qu’un studio finance The Modern Ocean, film d’aventure et de pirates de Shane Carruth, produit par Fincher et Soderbergh, avec Anne Hathaway, Keanu Reeves et Daniel Radcliffe. Il fallait que Josh Trank sorte sa version des 4 Fantastiques aussi. On peut en lister des dizaines comme ça. J’ai donc un peu de mal avec l’idée que Zack Snyder est un cas à part, qui dépasserait les autres. Faire un tel film, avec de tels enjeux, va avec des contraintes immenses.
Pour nous, l’évidence est : il fallait qu’il suive ses plans, c’est un artiste.
Pour Warner, c’était peut-être : il faut revoir ces plans, ce n’est pas tenable sur le moyen terme.
Quand on parle de films à 200 ou 300 millions hors promo, on ne peut pas balayer le business pour uniquement parler art. Mais bon, rien n’est impossible : le remontage de Superman II, Southland Tales ressorti en Blu-ray version director’s cut, et le Snyder Cut le prouvent. Donc son arc de cinq films existera peut-être, sous une forme ou une autre.
Simon : Je ne comprends même pas la formulation. On ne parle pas d’un canard sauvage, fauché en plein vol par un vilain chasseur. La seule légitimité de Zack Snyder (et de tout réalisateur) à faire un film, c’est sa capacité à le réaliser, ou à trouver des gens qui souhaitent lui donner les moyens de le faire.
Étant donné ce que coûtent les films de Snyder, il a besoin pour y parvenir, des centaines de millions d’un studio. Si ce dernier estime que se retrouver sur les bras avec un des machins les plus laids de l’histoire du cinéma, inexploitable en salles, après deux contre-performances au box-office, je vois assez mal ce qu’il y a rétorquer à ça.
Et puis, que Snyder, réalisateur passionnant s’il en est, sorte de l’industrie ultra-normée et javellisée des super-héros pour revenir à des projets plus personnels, j’y vois plutôt un motif de satisfaction.
Passons à un sujet qui fâche (rires). Que pensez-vous de la stratégie de Marvel Studios pour son Marvel Cinematic Universe ?
Geoffrey : Là encore, j’oublie mon petit avis sur ces films. La stratégie, le projet, c’est indubitablement quelque chose de fou et d’unique. Le terme « visionnaire » est galvaudé, mais là c’est visionnaire. Aujourd’hui, on regarde vite ça d’un air blasé, en répétant à quel point c’est une usine, qui uniformise le scénario, la réalisateur, les effets visuels. Peut-être, probablement, sûrement. Mais quand ça a été doucement lancé en 2008, c’était un énorme pari.
Je sais qu’on peut tous en avoir marre, parfois, de ces super-héros. Mais je fais régulièrement une pause pour me dire qu’on assiste à quelque chose de jamais vu. On est clairement en plein dans quelque chose qui sera le chapitre d’un livre sur l’histoire du cinéma américain. Et encore une fois, je ne parle pas de la qualité des films : Hollywood a toujours été une usine, ça n’a rien de nouveau, seule la couleur des jouets change dans les rayons. On peut pleurer sur ça, et heureusement que tant de gens questionnent et critiquent ce modèle. Mais d’un point de vue froid de business, Marvel a réussi quelque chose d’énorme.
Simon : En termes de stratégie, c’est une réussite éclatante. Non seulement pour Disney, qui a connu une réussite plus massive que jamais auparavant dans son histoire, mais aussi en regard d’Hollywood, qui singe depuis dix ans la recette Marvel, sans y parvenir.
Qui dit stratégie global, dit formatage des contenus qui reposent tous sur un même cahier des charges. Toutefois, y-a-t-il un contenu Marvel Studios qui à vos yeux a su faire la différence ?
Geoffrey : J’aime l’écriture de Joss Whedon sur le premier Avengers (qui m’a parfois rappelé les grandes heures de Buffy), et la mise en scène de Joe Johnston sur Captain America. L’alliage des deux, je dirais que c’est James Gunn avec Les Gardiens de la Galaxie. J’ai toujours la sensation qu’il a exploité au mieux la formule Marvel, dans un mariage d’émotions, de fantaisie, d’humour, d’aventures, et de second degré (avec ses personnages, mais également le MCU lui-même). Et j’en ai marre des super-héros qui défendent du goudron dans une métropole, donc tout ce qui est véritablement cosmique, c’est un grand oui.
Simon : Le premier Captain America est un film d’aventure rétro assez imparable. Le second Gardiens de la Galaxie me fait immanquablement chialer, mais je mets ça sur le dos de Kurt Russell.
Pour rester dans le monde des super héros, Warner Bros et DC Films parlent désormais de multivers. Une stratégie qui permet de placer tous les films existants – des Superman de Richard Donner aux films les plus récents – dans le même multivers sans pour autant se soucier d’une quelconque cohérence. Où va Warner selon-vous ? Faut-il s’attendre à un Crisis On Infinite Earths au cinéma ?
Geoffrey : Est-ce qu’ils savent eux-mêmes où ils vont ? Et est-ce que finalement, c’est si important ? En ayant la tête dedans, médias et fans, on oublie qu’une grande partie du public se fiche peut-être de ces « détails ».
Quand Joker est sorti, c’était d’abord un film, avant d’être « mais est-ce que c’est la même timeline que ce Batman ? ». Quand Dark Phoenix est sorti, c’était d’abord un film (nul), avant d’être « encore cette histoire de Jean Grey ? C’est un remake ou pas ? ». Quand Superman apparaît à la fin de Shazam, c’est d’abord Superman, avant d’être Henry Cavill (ou pas). Quand Spider-Man est rebooté 2 fois d’affilée, ça restait d’abord un film Spider-Man.
Donc je ne sais pas à quel point ça pose problème au fond. Les croisements qu’il y a eu entre les films et les séries de l’Arrowverse montrent que c’est d’abord une source de petit plaisir, et pas forcément plus. D’autant que j’aime bien la liberté que ça peut laisser, pour que DC ait sa propre identité. J’aime Man of Steel et Aquaman, mais il y a un gouffre entre les deux, et c’est sûrement possible car il n’y pas d’univers étendu strict.
Dans l’idéal, ça laisse plus de place aux cinéastes, et ça exploite la richesse des comics et des personnages – au lieu de tout ramener sur une ligne générale. Toutefois, on sait que les comics Marvel s’étaient cassés la gueule dans les années 90, à force de trop ouvrir d’univers parallèles et s’y perdre. Il y a donc un risque. Je suis très curieux de voir ce que ça va devenir d’ici 5-10 ans.
Simon : Je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre, et je les soupçonne de ne pas non plus en avoir la moindre idée. Si Warner veut user de cette carte pour tout remettre à plat et tenter de se donner une direction claire, pourquoi pas. Mais plus sérieusement, si ces studios s’avancent véritablement sur cette voie… je pense qu’ils le regretteront.
C’est un concept qui me paraît peu fédérateur auprès du grand public, très piégeux dans le temps (du genre à scinder le public ou à être un écueil à l’arrivée de nouveaux spectateurs), et c’est déjà ce type de développement qui a failli causer la banqueroute de Marvel, au tournant des années 90.
Attention, question difficile (rires). Qui est le meilleur… Batman ? Bruce Wayne ? Film Batman ? Et pourquoi ?
Geoffrey : Simon en parlera mieux que moi, parce que pour le coup je suis peu sensible à ce personnage. Pour moi, le meilleur DE Batman, c’est Michelle Pfeiffer en Catwoman. Donc Batman le défi est mon préféré, sûrement parce que je m’en fous de Batman dedans (comme Tim Burton), et parce que c’est le seul qui peut me faire verser une larme tout en m’émerveillant.
Simon : Le meilleur Bruce Wayne, c’est Michael Keaton. Parce que c’est le seul à en avoir fait un personnage complet. Après lui, il n’y a eu que des concepts. Des émotions. Son Bruce est le seul à avoir une personnalité propre, des enjeux qui ne soient que les siens.
Le meilleur Batman… c’est peut-être celui de Bale, malgré sa voix, qui m’agace terriblement, il y a dans ce Batman une intranquillité très intéressante, une sorte de sur-compensation permanente qui le rend passionnant.
Le meilleur film consacré au personnage c’est évidemment Batman Returns. Parce que ce n’est pas un bon Batman. Ou un bon film de super-héros; C’est simplement un chef d’œuvre, qui, de son écriture, en passant par sa musique, sa mise en scène, son montage, sa photo, son interprétation et sans doute le menu de sa cantine, impose à la fois une vision profondément original, un spectacle total, et une poésie qu’on n’a plus jamais retrouvé chez le personnage.
Si vous deviez vous identifier à un personnage de fiction, lequel serait-ce ? Et pourquoi ?
Geoffrey : J’hésite entre April dans Parks & Recreation, et Dark Smith dans Nowhere.
Simon : Le fils, dans Big Fish. Je partage avec lui le désarroi profond d’avoir souvent le sentiment d’être balloté par des héritages, que je ne peux m’approprier qu’en les racontant, et qui parfois m’emportent. Son rapport au récit, à la fiction, et donc à la foi et ultimement au don, me bouleversent.
Ces dernières années, Hollywood a massacré plusieurs franchises iconiques : Die Hard, Predator, Terminator etc. Diriez-vous qu’il faudrait les abandonner ?
Geoffrey : Abandonner, je ne sais pas, mais repenser, et faire une pause… certainement. Je ne vais pas crier au scandale par principe, parce que recycler une marque, un univers, ça n’a rien de nouveau. Des Universal Monsters aux comics, en passant par les jeux vidéo, ça a toujours été un moteur de la pop culture.
Tant mieux, tant pis, c’est comme ça, et ça donne parfois de belles choses. Mais là, le grand écart est trop grand : on part de purs films de cinéastes, avec des budgets relativement petits, pour arriver à de gros produits hollywoodiens. The Predator est sûrement le symptôme ultime : Shane Black était un choix intéressant, et ça se voit dans plusieurs scènes décalées, mais le studio a sûrement eu peur, et fait marche arrière pour rester dans les clous.
Résultat : ça n’a aucun sens, aucune âme. Il n’y plus aucun risque, aucune vision, aucune évolution. Même chose pour Terminator : le quatrième opus réalisé par McG a des défauts, mais au moins il sautait dans l’inconnu du post-apocalyptique. Sauf qu’après, ils sont revenus dans le pré-apocalyptique, encore et encore. Évidemment que ça tourne en rond. La saga Alien devrait servir de modèle : de vrais cinéastes, de vrais risques narratifs, et beaucoup de choix radicaux qui ferment des portes (tuer Hicks et Newt, tuer Ripley et la faire revenir en clone).
Simon : Je dirais que le massacre a été tel que je n’ai absolument plus rien à carrer de leur avenir.
Avez-vous déjà changé d’avis au sujet d’un film ?
Geoffrey : A peu près tout le temps. Un exemple : A.I : Intelligence Artificielle, réalisé par Spielberg. Je l’ai vu jeune, avec une envie de pure SF. Je n’ai rien compris, j’ai été totalement perdu en cours de route. Et quand je l’ai revu plus tard, j’ai trouvé ça majestueux et magnifique. Un de mes Spielberg préférés maintenant.
Simon : Oui, souvent. Récemment, au sujet de The Predator, que j’ai d’abord vécu comme un monstrueux ratage doublé d’un crachat. Et qui me paraît aujourd’hui une sorte de doigt d’honneur punk traversé de trouvailles assez géniales.
Parlons d’Ecran Large. Est-il juste de dire qu’il y a une nouvelle dynamique au sein de votre rédaction ?
Geoffrey : Une rédaction, ça évolue constamment. Diriger un site comme Ecran Large, c’est une bataille perpétuelle, pour exister, continuer, s’adapter et se défendre, sans jamais oublier ce qui compte – la passion pour le cinéma, les séries, les jeux vidéo, les comics etc. Et comme avec un gros paquebot, un changement prend du temps.
Depuis maintenant 3-4 ans je dirais, on a lancé plusieurs chantiers, à la fois dans la ligne edito, et dans l’équipe. D’un côté, il faut exister sur le marché, couvrir l’actu et en tirer profit. De l’autre, il ne faut jamais s’y noyer et s’y perdre, à la fois pour les lecteurs et lectrices, et pour l’équipe elle-même. Cet équilibre est difficile à tenir. Depuis quelques années maintenant, on a assemblé une équipe assez complète, unie, diversifiée mais harmonieuse. On se complète bien, on s’entend bien, et on s’écoute. On est beaucoup plus exigeants et clairs avec nous-mêmes, et ça nous permet d’être plus ambitieux, et de prendre quelques risques pour avancer.
Simon : Je ne crois pas. Ou plutôt, il n’y a pas ‘une nouvelle dynamique’. La nature d’EL, qui est celle d’un média web, est par essence d’être fluide et de toujours se penser comme sur le point de se réinventer, pas pour survivre, ou dans la contrainte, mais parce que considérant la cinéphilie et sa transmission comme une matière éminemment fluide et ne pouvant être cantonnée à un seul format d’expression.
J’ai parlé de ‘nouvelle dynamique’, car nous sommes nombreux à avoir remarqué qu’il y a davantage de contenus et notamment de la vidéo. Y-a-t-il un lien entre la crise sanitaire et ce second souffle que l’on ressent chez Ecran Large ?
Geoffrey : Le chantier YouTube était déjà lancé depuis un moment, on avait fait pas mal d’essais, on avait appris de nos erreurs. 2020 devait être le grand lancement et il se trouve qu’on s’est tous pris 2020 dans la tronche. Au milieu de ce bordel, avec une équipe réorganisée pendant le confinement et une actu bouleversée, on a pu concrétiser des choses dont on avait envie. Hors vidéo, sur les articles, on monte en puissance année après année, avec toujours la même envie de parler mieux et plus, de davantage d’œuvres. Mais ce n’est pas lié à la crise, c’était lancé avant et c’est un chantier sans fin. Parce qu’on peut et veut toujours faire mieux.
Simon : Non, la volonté et le projet d’intensification de la vidéo étaient bien antérieurs. En revanche, la crise sanitaire a sans doute facilité et accéléré les choses.
D’ailleurs, pouvez-vous nous présenter les autres ‘acteurs’ de la rédaction :
Geoffrey : Il y a d’abord l’équipe interne, avec Simon et moi, et deux autres personnes : Alexandre Janowiak, secrétaire de rédaction et rédacteur, qui vénère David Fincher et The Leftovers ; et Mathieu Jaborska, rédacteur et community manager, qui vénère Cronenberg et le gore.
Ensuite, il y a les freelances, quasiment tous d’ex stagiaires, avec des domaines ou des sujets de prédilection: Déborah Lechner (films d’animation et animes), Arnold Petit (comics), Prescilia Correnti(jeux vidéo), Camille Vignes (séries), Elliot Amor (animes, mangas), Flavien Appavou (mangas, animes), Mathias Penguilly (séries) et Lino Cassinat (un peu tout).
Enfin, il y a nos super stagiaires : Antoine Desrues, Salim Belghache et Maeva Antoni.
A côté de la rédaction, il y a l’indispensable Maximin Bulteau, notre cadreur et monteur, et Lena Lescureux, qui s’occupe des partenariats.
Est-ce que le format vidéo vous a donné une nouvelle proximité avec votre lectorat ?
Geoffrey : J’ai surtout l’impression qu’un nouveau lectorat nous a découverts. Pas mal de gens apprennent l’existence d’Ecran Large via YouTube, et ne savent pas que le gros de notre travail est sur le site. Pour les autres, c’est effectivement un moyen de se rapprocher de nous, et mieux nous définir. Comme on revendique notre dynamique d’équipe, et qu’on rappelle constamment qu’Ecran Large c’est une rédaction avec des personnes ayant des avis et des personnalités différentes, la vidéo permet d’incarner tout ça.
C’est une continuation logique et naturelle de ce qu’on fait et écrit au quotidien : discuter, débattre, blaguer.
Simon : C’est difficile à dire. J’ai le sentiment que ça ne change pas drastiquement des retours que nous recevons sur d’autres formats. Ils diffèrent sur la forme, mais on observe des schémas et des comportements qui me paraissent assez voisins. Certes, il y a une forme d’identification et d’affect qui sont plus marqués via les formats vidéo, mais comme nous fonctionnons là aussi en rédaction, et qu’il n’y a pas un visage unique qui incarne EL, ça a tendance à amoindrir un peu cet aspect, ou à le rendre plus diffus.
Avez-vous été surpris par l’accueil positif de ces nouveaux contenus ?
Geoffrey : Je m’attendais vraiment à beaucoup plus de violence dans les commentaires. Il y en a, et on les modère comme sur le site et sur les réseaux sociaux pour protéger l’espace d’échange. Mais je m’étais préparé à pire honnêtement.
Simon : Pas surpris qu’il y ait des retours positifs dans l’absolu. On avait très envie de se lancer depuis un moment, nos expériences, chacun de nos côtés, sur d’autres médias, d’autres formats, nous laissaient penser qu’il y avait non seulement un public qui pouvait s’intéresser à ce qu’on avait envie de proposer, tout comme il nous semblait qu’en bossant, on pouvait réussir à amener ce qu’on fait sur le site, sur Youtube. Ensuite, oui, la forme, souvent très directe, incarnée et personnelle que prennent les retours est toujours surprenante. Et stimulante.
Vous accordez également une place particulière aux jeux vidéo. En tant que joueur, quelle a été votre plus grande claque vidéoludique ?
Geoffrey : Malheureux, c’est un terrain glissant ça, je vais être obligé de reparler de Tomb Raider. La Révélation finale a été un moment majeur dans ma vie de joueur, parce qu’il m’a ouvert un imaginaire en 3D, et m’a fait tomber amoureux de cette saga qui me passionne encore.
J’ai grandi avec les mélodies et les couleurs de Streets of Rage et Golden Axe sur Mega Drive, mais la Playstation a tout changé pour moi. Et comme je ne peux pas accepter l’idée de ne citer qu’un jeu, je vais dire : les trois premiers Resident Evil, les trois premiers Silent Hill, Bioshock, Half Life 1 et 2, Alone in the Dark 4, Parasite Eve 2, Dead Space, Alien : Isolation, Horizon : Zero Dawn, et la trilogie Mass Effect. Côté plus indé : The Talos Principle, Fez, Limbo, A Plague Tale : Innocence, et pas mal de points and click comme Mystery Case Files.

Au fond, c’est quoi la peur ? Et à fortiori la peur, manette en main ? On peut s’arrêter sur une définition assez simple, quoique très peu de jeux parviennent à en remplir les critères. Ce serait la rencontre, fructueuse, entre la terreur d’un côté (l’adrénaline, l’excitation provoquée par le surgissement brutal d’une monstruosité hostile, la mécanique de Resident Evil, en gros) et l’angoisse de l’autre (soit une crainte beaucoup plus irrationnelle, volontiers existentielle, qui ne s’incarne pas tant dans un ennemi ou une figure abominable, mais dans un réseau de signes, qui sapent notre capacité à nous fier à notre environnement). Quand ces deux logiques co-existent et s’entrechoquent, qu’on traverse un décor en courant parce que la créature qu’on a entraperçu dans un recoin nous terrifie, et que le sentiment d’absolu vertige qui nous étreint à chaque intersection augmente, alors oui, là, on est dans la peur.
Et ce que nous montre Silent Hill 2, c’est que la peur devient elle-même un tremplin poétique et méditatif qui autorise à peu près toutes les folies, toutes les expérimentations. Jusqu’à nous emmener dans des zones très troubles, sans réponse définitive. Explorer la psyché de James, en marchant aux côtés de Maria, c’est une expérience de l’éblouissement amoureux transmise et par la mise en scène, et par le gameplay. Errer dans les rues de Silent Hill, c’est une traversée introspective plutôt démente. Comprendre qu’Angela est ici pour venger un inceste et ultimement se damner, c’est un uppercut.
Et puis, on se passionne, à raison, aujourd’hui pour les narrations in-game, environnementales. Certes Silent Hill 2 repose en grande partie sur ses cinématiques. Mais c’est bien le gameplay et le cheminement du joueur qui prend en charge une proportion non-négligeable du sens, des émotions, et donc de la qualité du jeu. On peut scruter toutes les cinématiques de SH2 et ne rien comprendre du récit, ou de son sens. En revanche, faire face, dans une boutique abandonnée, à ces quelques mots gribouillés sur des journaux, ‘THERE WAS A HOLE HERE, IT’S GONE NOW’, c’est plonger à pied joints dans un terrier du lapin blanc dont je ne suis toujours pas sorti, 20 ans plus tard. Bref, c’est un peu de la balle.
Geoffrey, récemment tu as proposé une vidéo qui synthétise la saga Tomb Raider. En tant que fan de Lara Croft, que souhaiterais-tu pour l’avenir de la franchise ?
Geoffrey : Vaste question… A un degré moindre, je pense que Tomb Raider est devenu comme Star Wars : on en a une perception différente selon la période où on tombé dedans. Je suis tombé amoureux de Tomb Raider à l’époque où c’était un jeu d’aventure solitaire, avec beaucoup d’exploration et de backtracking, avec un sens du merveilleux voire de l’horrifique très prononcé. C’est Lara Croft qui explore seule des endroits oubliés par le temps, repris par la nature, et hantés par des choses surnaturelles. Avec un sentiment d’isolement incroyable et magique.
Donc c’est ce que j’aimerais retrouver. Parce que cette vibe Uncharted a condamné les jeux récents : ça n’est pas aussi épique qu’Uncharted, parce que ça arrive après et que ça ne va pas aussi loin. Je pense que Tomb Raider a besoin de faire une pause et trouver un axe d’évolution un minimum révolutionnaire (c’est ça qui l’a fait naître à la base). Et pour ça, je pense qu’ils doivent arrêter avec leurs budgets énormes, parce que de toute évidence ça étouffe toute créativité tellement il y a d’enjeux.
Simon, de ton côté y-a-t-il un jeu / une franchise / un concepteur que tu souhaiterais évoquer dans une vidéo ?
Simon : Alors bon, du coup Silent Hill, oui, ça me titille pas mal. Mais j’ai très envie de me repencher sur la saga Legacy of Kain, Soul Reaver. En termes de pure création d’univers et de direction artistique, on touche à quelque chose de très important.
Un monde dont la mythologie est une excroissance de plusieurs figures mythiques communes, une appropriation de genres et de sous-genres pas franchement inédit, mais qui parvient à imposer une singularité remarquable. La direction artistique est affolante. A un point tel, qu’on peut raisonnablement soutenir qu’il n’y a que deux grands jeux au sein de la série, Blood Omen : Legacy of Kain et Legacy of Kain : Soul Reaver.
Et pourtant, les épisodes qui leur ont succédé ont pu passionner encore, par les seules grâces d’une direction artistique phénoménale et d’une dimension épique et nostalgique qui poussait à prolonger l’aventure. Aventure qui trouve ses racines dans quantité de récits séminaux, Raziel a quelque chose de génial dans sa dimension tragique. C’est un Ulysse mutilé et amoindri, qui avance vers un Ithaque dont il n’est même pas sûr qu’il existe, et dont chaque nouvelle ruade contre le destin vient l’enchâsser un peu plus dans une mécanique fatale.
Du coup, je suis assez curieux de cette série, qui m’a retourné le cerveau, et qui, si on veut être un peu méchant ou malicieux, a presque réussi à prouver qu’on pouvait – un peu – s’affranchir du gameplay et proposer un grand récit qui tienne à son atmosphère, ses protagonistes, son univers, sa musique… et ses dialogues. C’est assez inhabituel, de se dire qu’un jeu vaut pour ses textes. Et pourtant, je me souviens d’être tombé de ma chaise. Écouter les joutes oratoires interprétées par Bernard Lanneau et Benoit Allemane, c’est un truc stupéfiant. Comme quoi, il existe un espace, où, comme le cinéma avant lui d’ailleurs, le JV peut attirer les autres arts et les utiliser comme matière première. Et puis bon, toute œuvre qui représente les vampires autrement que comme des rock stars dégénérées en pantalon de cuir pétées à la cocaïne mérite un immense respect.
Comme moi, diriez-vous qu’Hideo Kojima est un auteur ?
Geoffrey : Je ne connais pas assez pour me prononcer sur son travail, mais avec mes connaissances limitées, je dirais oui, sans hésiter. Et si la question derrière est de savoir si un créateur de jeu vidéo peut être un auteur, alors oui, sans hésitation aucune.
Simon : A partir du moment où absolument tout le monde a une idée de ce qu’est un jeu d’Hideo Kojima, c’est incontestablement un auteur.
Pour autant, le voyez-vous à la direction d’un long-métrage ?
Geoffrey : Vu l’ambition visuelle et narrative de Death Stranding par exemple, j’aimerais beaucoup oui. Encore une fois, je ne suis pas grand connaisseur, mais je sens toujours un énorme appétit de cinéma, et il travaille sur cette frontière dans le rythme, la narration, l’écriture. La question est de savoir où il pourrait concrétiser un tel projet : un budget de blockbuster semble idéal, mais pas sûr que ça lui donne la liberté qui va avec son univers.
Simon : J’adorerais me tromper, mais il me semble que ce qui fait la – grande – valeur de ces travaux est parfaitement antinomiques du cinéma. Il créé de l’émotion en travaillant l’interaction, et en questionnant le joueur sur son rôle et le sens de ce dernier. Autant de concepts qui n’existent pas au cinéma.
Quelles sont dans vos vidéos, celles qui vous semblent les plus intéressantes, qui vous tiennent le plus à cœur, et pourquoi ?
Geoffrey : Je suis systématiquement frustré de pas pouvoir en dire plus, parce que la question de la durée des vidéos est toujours là, mais je suis pas trop mécontent de celle du Total Recall, où j’ai pu survoler plein de choses, autant dans le scénario que les effets visuels. Celle sur Tomb Raider était un peu un rêve, et elle a bien marché à notre échelle, donc je suis ravi. J’aime aussi beaucoup celle sur Buffy, avec Camille Vignes, parce qu’on en parlait depuis environ 2 ans (et même si on voulait évidemment faire beaucoup plus long sur le sujet).
Globalement, ce sont des vidéos avec une fibre nostalgique très forte, qui me ramènent à mon enfance ou mon adolescence.
Simon : La prochaine.
Quelle(s) chaîne(s) youtube cinéma conseillerez-vous aux lecteurs ?
Geoffrey : La Boîte à FX, parce que c’est un passionné qui décortique les effets visuels avec une précision folle. Zoétrope, parce que j’ai beaucoup aimé sa vidéo sur les teenmovies, passionnante et très bien montée. Les Chroniques de Vesper aussi – obligé, elle a fait une super vidéo sur Tomb Raider.
Simon : Le cinéma de M. Bobine, Intercut et Demoiselle d’Horreur. Mais je ne suis pas très chaîne ciné. Je préfère les bouquins. Mais pour le coup, les captations des conférences de Thoret sont très bien.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux jeunes créatifs qui souhaitent partager leurs univers sur la toile ?
Geoffrey : D’y aller sans (trop) hésiter ! Tout le monde a sa place. Qu’on aime les blockbusters ou les films dits d’auteur, qu’on soit une pile électrique ou qu’on ait une voix très posée, qu’on ait envie de parler d’actu ou de vieux films datant des années 60, qu’on veuille parler divertissement pur ou politique… Il y a plein de publics, et donc plein de place. A titre perso, j’aime beaucoup voir des personnes aussi différentes avoir des chaînes, je pense que c’est très important pour se dire que beaucoup de monde a une voix légitime, et peut l’utiliser.
Simon : Ils feraient mieux de faire ça sur Internet. C’est très bien les toiles, mais les galeries d’art n’ont plus le vent en poupe et les musées sont fermés.
Si vous pouvez vous adresser un message à vous-même à l’âge de 10ans, lequel serait-ce ?
Geoffrey : J’avais envie de faire une blague, mais en fait non. Je le préviendrais qu’il va découvrir ce qu’est l’homophobie ordinaire dans les cours d’école, que ça va l’inciter à se faire un barrage pour ne pas l’affronter tellement c’est violent, mais qu’il devrait plutôt demander de l’aide, et foncer dans le tas. Bien sûr, il n’obéirait pas, parce que c’est 15 ou 20 ans après qu’on comprend ça.
Simon : ‘Méfie-toi de Geoffrey Crété !’
Que feriez-vous avec un budget digne d’un blockbuster ?
Geoffrey : Je fais une grande pause dans ma vie pour réaliser 3, 4 ou 5 films avec des mid-budgets, et sans claquer 150 millions en promo.
Simon : Je mettrai sur pied un projet de d’anarcho-démocratie auvergnate dont les deux premières valeurs seraient la truffade, le vin rouge, et les maths.
Je fais appel à votre esprit créatif. A vous de me proposer quelque chose et de commenter.
Geoffrey : J’aimerais partager les concept arts de mon film, mais je ne peux pas encore le faire. Donc voici un beau xénomorphe acheté sur les puces, et créé avec des pièces de récupération. Ce que je trouve très malin pour rendre hommage à Giger.
Simon :
Quelles sont vos œuvres de références ?
Geoffrey : En films, Synecdoche, New York, The Hours, Magnolia, Tenue de soirée, Mysterious Skin, Aliens le retour, UpstreamColor, Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant.
En série, Six Feet Under, Buffy contre les vampires, Battlestar Galactica. En livre, Celui qui chuchotait dans les ténèbres de Lovecraft, Construire un feu de Jack London, et Hyperion de Dan Simmons.
Simon : Massacre à la Tronçonneuse, Apocalypse Now et Buffet Froid pour le cinéma. Ubik, ça, Rodogune et Le Grand Meaulnes pour les bouquins.
Et quelles sont vos attentes ?
Geoffrey : La série Fondation, le remaster de Mass Effect, et ce film que Todd Solondz est censé faire avec Edgar Ramírez, Penélope Cruz, intitulé Love Child.
Simon : Si je les connaissais, je ne les attendrais plus.
En préparant cette interview, j’ai cherché comment on pourrait qualifier votre binôme. Finalement, je me suis dit que vous êtes les Starsky et Hutch de l’actualité cinéma, mais lequel de vous deux est Starsky ? Qui est Hutch ? (Rires)
Geoffrey : J’ai été sur Wikipedia pour répondre, et je peux clairement dire que je suis Hutch.
Simon : C’est donc là que je dois confesser ne jamais avoir vu aucun épisode de Starsky et Hutch. Alors du coup dans The Nice Guys, je serais probablement Russell Crowe. Physiquement. Parce que si on est un petit peu honnête, celui qui peut raisonnablement mettre une déculottée à l’autre, c’est Geoffrey, et celui qui est le plus susceptible de se brûler avec une cigarette sur la cuvette des toilettes, ce n’est pas Geoffey.
Si votre binôme était un buddymovie, quel serait son titre ? Et sa phrase d’accroche ?
Geoffrey : Les Aventures de Tango et Crash dans les griffes du pangolin.
Simon : Vin et Diesel. Deux carburants pour un seul moteur.
Que voudriez-vous dire à votre lectorat, vos abonné(e)s et aux prochains ?
Geoffrey : Déjà, merci, parce que l’écrasante majorité est super sympa, passionnée et bienveillante. Et sinon, qu’ils et elles ont un pouvoir à ne pas négliger. Comme quand on achète un ticket de cinéma pour un film plutôt qu’un autre, le choix des articles qu’on va lire ou ignorer n’est pas anodin. En tout cas, on le voit chaque jour.
Simon : ‘ça va bien se passer’.
Pour terminer, quelle question auriez-vous souhaité que je vous pose et qu’auriez-vous répondu ?
Geoffrey : « A quel point Simon se sent intellectuellement et physiquement menacé par toi ? ». Et je n’aurais pas répondu, par respect pour lui.
Simon : « – Quelle est la différence entre un merle ?
– Aucune, il a les deux pattes pareilles. Surtout la gauche. »
Encore une fois merci Geoffrey, Simon d’avoir participé à Adopte un Créatif.
Geoffrey : Merci à toi, j’adore raconter ma vie comme si j’étais important.
Simon : Mais de rien !
Propos recueillis par Thomas O. pour Eklecty-City.fr, qui remercie Geoffrey et Simon de s’être prêtés au jeu d’une interview.